Ceccaty, René de
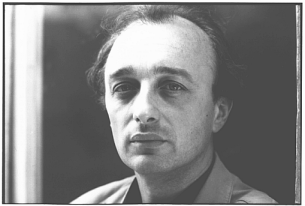 |
René de Ceccatty est né le 1er janvier 1952 à Tunis. Il est romancier, traducteur, critique littéraire et éditeur. Il a fait des études de philosophie. Il a vécu au Japon et en Angleterre. Il collabore régulièrement au Monde des livres. Il fait partie du comité de lecture des éditions du Seuil. Il travaille également pour le théâtre avec le metteur en scène argentin Alfredo Arias pour lequel il a participé à l'écriture de Mortadela (Molière du Meilleur Spectacle Musical 1993), de la traduction de Cachafaz de Copi (Théâtre de la Colline, 1993), des chansons de Fous des Folies (Folies Bergères, 1993-1994), du one-woman-show Nini (Théâtre du Petit Montparnasse, 1995), de Faust Argentin ( Théâtre de la Cigale, 1995, Mogador, 1996). Expérience éditoriale Lecteur chez Denoël à partir de 1980. Lecteur chez Gallimard 1982-1986. Attaché à la direction littéraire chez Gallimard en 1987. Directeur littéraire chez Michel de Maule en 1988. Directeur de la collection " Haute Enfance " chez Hatier depuis 1989-1992, chez Gallimard à partir de 1992. Conseiller littéraire aux éditions Stock, 1994 Conseiller littéraire, membre du comité de lecture des éditions du Seuil, depuis février 1995 Expérience journalistique Collaborations à de nombreuses revues : NRF, Quinzaine littéraire, Magazine littéraire, Europe, Nuovi Argomenti, Il Messaggeroetc. Critique littéraire au Monde depuis décembre 1988. René de Ceccatty Une vie partagée entre la littérature, l'écriture, le rêve et l'art Dans La sentinelle du rêve vos personnages ne perçoivent la réalité qu'à travers des filtres littéraires ou philosophiques et leur vie éveillée compte moins que leur vie rêvée. Pour vous, l'écriture est-elle un rêve qui permet de vivre ? Il y a la littérature, l'écriture, le rêve et l'art. J'ai écrit La sentinelle du rêve dans une période où je renonçais presque à la vie. Je travaillais chez Gallimard mais je n'étais pas fait pour une existence régulière, salariée, ce que je n'ai plus au Seuil où je me sens plus libre. J'ai compris que ce qui constituait vraiment ma vie était la littérature et le rêve. La littérature à travers Violette Leduc et Pasolini qui sont les modèles des personnages du livre et également Foucault dont j'évoque la mort et qui a joué un grand rôle dans ma formation. Je m'intéressais au rêve et à la littérature comme si je ne pouvais plus, avec ma vie affective et corporelle, m'installer vraiment dans le monde. La revanche de l'écrivain est de contrôler ce qui dans sa vie ne l'est pas du tout. Je donne beaucoup d'importance au rêve parce que c'est un moment où les choses se réorganisent de manière parfois très forte et très structurée selon un autre cheminement que dans la littérature. Le rêve est un guide. Linconscient se structure selon des systèmes métaphoriques qui lui sont propres. C'est fascinant pour un écrivain. J'ai beaucoup réfléchi à la liberté de l'écriture jusque dans l'intimité. J'ai écrit ce livre pour décrire l'état psychologique dans lequel j'étais de renoncement au monde. Dans plusieurs de vos écrits dont Aimer, L'accompagnement, Le diable est un pur hasard... vous mêlez votre vie et la fiction sans délimiter de frontière. C'est vrai que j'ai brouillé les cartes. Dans mes livres, je me suis servi d'éléments autobiographiques marquants.Dans Aimer, je me suis donné la totale liberté de réinterpréter, de falsifier en partie des éléments et d'intégrer des personnages de fiction. / Au moment où jai écrit Aimer, je voulais parler d'un événement de ma vie qui m'obsédait, une histoire d'amour avec celui qui se prénomme Hervé dans le roman. C'était une histoire extrêmement douloureuse et je ne voulais pas en parler directement pour ne pas donner de détails qui risquaient de trahir celui dont je parlais. Parler d'une histoire malheureuse c'est entrer dans l'intimité de deux êtres or le regard que l'on porte à travers l'amour est un regard partial. J'ai donc eu recours à un personnage très proche de moi et en même temps totalement différent, Harriet Norman. Elle allait parler sur moi d'une manière plus légère que je ne l'aurais fait moi-même. J'étais heureux de retrouver une amie. Je l'ai fait mourir parce que c'était une très vieille dame. J'ai introduit un personnage imaginaire Ishmael que beaucoup de lecteurs ont cru réel. Ishmael portait sur moi un regard extrêmement bienveillant, il était mon garde-fou. Ishmael, étant un hétérosexuel tout à fait libre, rappelait que le drame vécu par le narrateur n'était pas l'homosexualité mais un amour malheureux. Cela me soulageait d'entendre cette voix lucide. C'était une manière de me rappeler que le problème que je décrivais n'était pas uniquement celui d'Hervé mais aussi le mien. Je m'étais enferré dans une situation dont je n'arrivais pas à sortir sinon par la littérature. Mais la littérature a des limites, on continue à être seul. Le lien entre la fiction et l'autobiographie se retrouve dans mes premiers livres. / En relisant La sentinelle du rêve pour la parution en Points Seuil, j'ai découvert que les personnages féminins complètement imaginaires avaient des histoires amoureuses inventées qui décrivaient déjà l'état que j'allais connaître dix ans plus tard. L'écrivain met à nu son fantasme en concevant un roman et ses rencontres prennent place dans une structure mentale d'une incroyable rigidité. / La limite entre la fiction et la vie réelle est extrêmement fragile. La vie intérieure appartient à la fiction. Dans l'attente, l'espoir, nous passons notre temps à constituer des romans. Quand on est inquiet pour quelqu'un que l'on aime on structure un délire imaginaire qui suit exactement les mêmes lois que la construction d'un roman ; pas en totalité peut-être, mais l'angoisse suit les lois de la construction d'une véritable intrigue. Il est donc naturel qu'il y ait ce glissement de la fiction à l'autobiographie. Aimer est constitué de petits chapitres. Est-ce que pour vous la vie est une somme d'éclats ? Pour Aimer c'est particulier. Je crois que dans la structure amoureuse, dans la passion, on interprète tous les événements qui concernent les rapports entre deux personnes, homme et femme, homme et homme, on réalise un travail d'enquête comme dans une histoire policière. J'ai écrit le livre de manière continue. Mon manuscrit ne comportait aucun chapitre, aucun titre et c'est en le recopiant sur l'ordinateur que je l'ai divisé en chapitres. J'ai compris que j'avais écrit des saynètes chacune autour d'un objet symbolique. Le livre est rythmé, ce qui permet de le lire extrêmement vite mais cela ne veut pas dire que ce soit ma perception systématique du monde. Il est vrai que la plupart de mes livres ont été structurés en chapitres brefs avec une idée forte chaque fois mais aucun de mes livres n'a été écrit sous cette forme au départ. J'ai toujours mis les titres des chapitres après coup. Vous donnez beaucoup d'importance à la correspondance et au manuscrit. Dans Aimer et dans Le diable est un pur hasard vous parlez de manuscrits. Oui, la correspondance compte beaucoup pour moi, j'écris beaucoup de lettres et j'aime avoir des relations épistolaires avec des amis. Je dis souvent aux écrivains qui débutent, d'écrire sous des formes diverses, de rédiger des journaux intimes, des lettres. Il est très important d'avoir plusieurs approches de l'écriture. / La correspondance est essentielle, car elle rend les choses parfois fausses dans leur rapport écrit, mais l'imagination est nécessaire si l'on veut se construire face à l'autre en rendant abstraite la relation. Je suis obsédé par l'abstraction des rapports humains et, par ailleurs, par leur sensualité : je suis obsédé par le détachement, la spiritualité et les rapports complètement intellectuels. / Je suis aussi passionné par les manuscrits. J'ai publié plusieurs manuscrits d'amis morts. Ce fut une expérience douloureuse et en même temps, j'étais heureux de pouvoir prolonger leur vie d'une certaine manière en publiant par exemple, Mémoires d'un jeune homme devenu vieux, les carnets de Gilles Barbedette qui sont très émouvants et vont au coeur du désespoir de la maladie. J'ai aussi publié La maison Niel, les souvenirs d'enfance posthumes, de Jean-Baptiste Niel qui était un grand ami et qui est mort du Sida en 1995. J'ai publié le dernier roman de Rabah Belamri Chroniques du temps de l'innocence. Pour moi, c'est un acte de respect par rapport à des oeuvres que j'admire et des écrivains qui étaient des amis. / Dans L'accompagnement votre rapport au temps n'est pas linéaire et ainsi vous redonnez vie à un ami. L'accompagnement a permis de prolonger un dialogue qui était à peine ébauché. Je ne le considère pas comme mon livre mais comme un livre écrit sous surveillance si l'on peut dire. Gilles Barbedette m'avait dit à l'hôpital qu'il n'avait plus la force d'écrire. C'était un acte militant car je voulais décrire le regard de Gilles sur la vie hospitalière. Il s'est révolté contre l'intrusion dans l'intimité, contre la dépossession de l'identité à l'hôpital. Il voulait parler de la douleur, de la moralisation de la souffrance quand on lui refusait des analgésiques. Il y avait aussi ses rapports avec les infirmières et les infirmiers qui étaient conflictuels ou admirables comme je le raconte à propos d'Annick qui est une femme vraiment fabuleuse. Elle a compris immédiatement le type d'attitude qu'elle devait avoir. Je parle aussi d'un médecin qui a eu une attitude tout à fait remarquable. Un travail objectif concernait Gilles mais je n'étais pas préparé à cette douleur d'accompagnement très aiguë dont il m'avait chargé. Il ne se rendait pas compte qu'il quittait le monde et que j'échangeais ce dernier regard humain avec lui. J'ai mesuré l'horreur de cette situation par la suite. Le livre est très littéraire. Le style doit l'emporter quoique ce livre soit écrit de manière extrêmement simple, mais bien sûr il comporte une mise en scène, une constitution strictement littéraire. Je ne voulais pas mettre entre parenthèses ma personnalité d'écrivain. J'allais parler de la douleur, de l'horreur de mourir dans un hôpital en prenant un certain nombre de précautions dans la manière de raconter. Vous avez beaucoup de relations au théâtre, est-ce que la vie se déroule sur la scène ou en dehors ? La frontière est ténue. Oui, c'est une ambiguïté. J'aime beaucoup Pirandello qui a écrit sur ce thème. Au théâtre l'émotion vient sans doute de la contradiction apparente entre la conscience d'assister à une fiction et la présence corporelle des comédiens qui créent un sentiment conflictuel et une émotion bouleversante. J'ai traduit une pièce de Moravia qui a été jouée à l'Odéon et j'ai surtout rencontré Alfredo Arias, metteur en scène argentin dont j'appréciais beaucoup le travail et avec qui j'ai collaboré à de nombreuses pièces, souvent musicales. J'ai suivi la préparation d'une demi-douzaine de ses spectacles en assistant parfois à toutes les répétitions. Vous avez choisi la littérature Oui, parce que je suis réservé et solitaire dans mon travail mais j'aime aussi le travail collectif. Je traduis avec un ami japonais Ryôji Nakamura. Au théâtre, l'artiste est comme un intermédiaire par rapport à une réalité artistique. Quand il écrit, quand il peint, quand il compose, l'artiste n'est pas complètement l'auteur de ce qu'il est en train de créer mais il est au service d'une réalité artistique dont il est l'interprète. Cela peut paraître paradoxal dans une oeuvre autobiographique et intimiste, mais il faut avoir cette idée pour que l'oeuvre ne soit pas strictement narcissique et renfermée sur elle-même. Vous avez aidé des auteurs à se révéler ? J'aime lire des manuscrits et découvrir des auteurs pour les éditer mais je n'aime pas entretenir de rapport paternaliste. Un écrivain doit sentir chez son interlocuteur une écoute, une attente mais c'est lui qui maîtrise son livre. Un écrivain qui est éditeur ou simple lecteur sert la littérature et il est nécessaire qu'il ait le même enthousiasme pour les livres des autres que pour ses propres livres, en aidant à la naissance de l'oeuvre d'un autre. J'ai édité des livres très différents parce que j'aime entrer dans d'autres systèmes littéraires. C'est pour cela que j'aime aussi la littérature étrangère. Vous avez traduit beaucoup d'ouvrages de l'italien et du japonais, vous découvrez des univers très divers. J'ai souvent réfléchi à la raison qui m'a poussé à tant traduire. J'ai commencé à traduire en écrivant quand j'étais encore enfant. J'ai un rapport très profond avec l'Italie parce que j'ai été élevé en Tunisie et que la personne qui s'occupait de moi était italienne. La deuxième motivation fut la découverte de Pasolini et c'est pour lui que j'ai vraiment appris l'italien. J'ai rencontré une littérature qui me parlait directement, une culture qui me révélait quelque chose d'intime. Bien sûr, c'est lié au rôle fondateur de l'Italie dans la culture européenne. Pour le Japon, le hasard a joué, j'ai été envoyé comme coopérant au Japon alors que je n'avais aucun lien avec ce pays. J'ai appris le japonais à ce moment-là et j'ai travaillé avec Ryôji Nakamura avec qui j'ai vécu et signé toutes mes traductions. J'ai découvert une littérature philosophique puis des textes classiques. On a conçu une anthologie, Mille ans de littérature japonaise. (Ed. La Différence, 1982 - Réed. fév. 98 ; Philippe Picquier) Quel rôle joue la traduction dans votre propre écriture ? Un rôle de premier plan : j'ai traduit des livres littéraires, des livres moins littéraires, des romans sentimentaux...Traduire des livres divers permet d'avoir une certaine distance par rapport à soi et aux mots. Cela aide à trouver sa propre voix. J'ai traduit Moravia par hasard, son traducteur avait trop de travail. Il m'a demandé de le remplacer. J'ai sympathisé avec Moravia et j'ai traduit tous ses derniers livres. Ce qui m'intéressait en traduisant Moravia pour qui j'avais une très grande admiration intellectuelle, c'était de voir comment fonctionnait un cerveau tout à fait différent, avec une autre personnalité, un autre âge, une autre génération, un autre cheminement. De plus il avait une renommée internationale et une faculté à s'intéresser à beaucoup de choses. Quand je traduis Pasolini ou le japonais Sôseki, que je ressens intimement proches de moi, je me reconnais à travers des écrivains pour qui j'ai une grande admiration. Ils ont une personnalité écrasante mais qui m'aide à me trouver moi-même. Kôbô Abé a un univers fantasmatique très éloigné de moi mais en même temps un univers fantasmatique minutieusement structuré. L'approche d'une langue à travers des idéogrammes permet une autre vision de la littérature. C'est une ascèse d'entrer dans cet univers. C'est long, très obsessionnel. Il faut respecter le style de l'auteur et surtout respecter le rapport entre le style de l'auteur et la langue d'origine mais ce travail sur la langue japonaise, je n'aurais jamais été capable de le faire seul. Vous êtes aussi critique littéraire. Oui, c'est un travail que j'aime vraiment beaucoup. La critique littéraire consiste à réfléchir sur le fonctionnement de la littérature selon des optiques très diverses. J'écris surtout sur la littérature japonaise et italienne dans Le Monde des livres mais il m'arrive aussi d'écrire sur des écrivains français ou anglais. Pasolini a tenu quelques années une chronique littéraire dans Il Tempo, j'ai fait un choix de ses textes que j'ai traduits en français sous le titre de Descriptions de descriptions. C'est un modèle de critique littéraire. Je crois qu'un chroniqueur n'est intéressant que s'il parle de son propre rapport à la littérature et à la vie. Dans mes articles, j'écris des choses très intimes mais qui sont codées bien sûr. Extraits des propos recueillis par Brigitte Aubonnet IN : Encres vagabondes, 1997. Depuis la parution en 1982 de Mille ans de littérature japonaise - une anthologie du VIIIe au XVIIIe siècle (La Différence ; réed. Philippe Picquier, 1998), en collaboration avec Ryôji Nakamura, René de Ceccatty n'a jamais cessé de traduire cette langue. Comment êtes-vous venu à la langue japonaise ? Par hasard. En 1977, professeur de philosophie, je débarque à Tôkyô pour enseigner dans le cadre de la coopération. Au ministère des Affaires étrangères, on m'avait proposé le Japon et je n'avais pas le choix. A l'époque, le pays était peu organisé pour les étrangers en transit. Les traductions en caractères latins étaient peu courantes dans le métro, aux concerts et dans la vie quotidienne en général. J'avais envie de participer à la vie culturelle, d'aller au théâtre... Il m'a fallu donc m'initier au japonais, par moi-même, avec des étudiants, puis dans une école de langues. Une fois rentré en France, je me suis inscrit à l'Inalco (ndlr : Langues Orientales). J'avais alors un niveau intermédiaire. Mais j'ai eu du mal à m'intégrer dans leur système d'enseignement. Je suis parti en Angleterre. Et la traduction, quand avez-vous commencé ? A Tôkyô j'enseignais la langue française, la civilisation et la philosophie. Ce cours exigeait le niveau de langue le plus élevé. Parmi mes élèves j'ai rencontré Ryôji Nakamura, qui revenait de Paris et parlait parfaitement français. Il est devenu un ami très proche. Je voulais traduire un texte de philosophie pour l'éditeur qui allait publier mon premier livre. Ryôji m'a parlé de Shôbôgenzô de Dôgen, le fondateur de la secte sôtô de zen. C'est par des extraits commentés de ce texte d'une extrême difficulté que nous avons commencé. La traduction a paru en 1980 à la Différence. Gilles Deleuze, Philippe Sollers et différents intellectuels l'ont remarquée. Mais avant cela, quand je suis revenu en France, Ryôji, lui, s'est installé en Angleterre afin de se perfectionner en anglais. Je l'ai rejoint dans le sud du Devon où nous avons vécu quelques mois. Nous avons alors eu l'idée d'élaborer une anthologie de la littérature japonaise classique, pour les Editions de la Différence. Elle ressort cet automne chez Picquier en collection de poche, dans une version légèrement remaniée. (Fev. 98) Quelle est la période "classique" de la langue japonaise ? Elle est beaucoup plus vaste qu'en Occident. Le sommet de la littérature se situe à l'époque de Heian, c'est-à-dire du VIIIe au XIVe siècle. Mais l'âge classique, au sens large, va jusqu'à la fin d'Edo, c'est-à-dire jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle. A la fin du siècle dernier, la langue parlée commence à s'intégrer dans la littérature, comme ce sera complètement le cas au XXe siècle. L'anthologie que nous avons traduite présentait plusieurs caractères particuliers. D'une part, tous les textes étaient traduits par nous. Ils étaient alors tous inédits en français. Certains y figuraient dans leur intégralité, ce qui donnait une originalité à ce volume. Plusieurs journaux de cour du XIe siècle, écrits par des femmes furent alors connus... / Quelle est votre méthode de travail ? Tous les livres que j'ai traduits du japonais l'ont été avec Ryôji, contrairement à ce que l'on croit parfois, c'est un vrai travail à quatre mains. Nous travaillons ensemble sur le texte que nous lisons simultanément et interprétons d'abord oralement, puis par écrit. Ryôji a, bien entendu, une connaissance beaucoup plus profonde du japonais. Mais, en travaillant ensemble, nous évitons tout malentendu. / Quelles sont vos autres activités ? Pour vivre j'ai dû beaucoup traduire, notamment quand j'ai quitté Gallimard. J'ai même traduit de la littérature sentimentale et des best-sellers. J'ai commencé à collaborer au Monde à la fin 1988, sur la proposition d'Hector Bianciotti, avec qui je travaillais chez Gallimard, et de Josyane Savigneau. Et j'écris également pour le théâtre, en collaboration avec Alfredo Arias dont jai publié au Seuil le premier livre, une sorte de roman autobiographique, des mémoires imaginaires : Folies-Fantômes. (Le Seuil, 1997) / Avec tous les livres que vous avez traduits, pourriez-vous vivre de vos traductions ? Non. Pas du tout. Une traduction est payée en à-valoir de droits d'auteur. Nous percevons une avance de 1 à 2% des droits. Les livres qui ont le mieux marché, ce sont les Amours interdites, de Mishima -et cela parce que son image d'homosexuel le fait vendre en France et à l'étranger. Et Sôseki, dont Oreiller d'herbes a été un succès inattendu chez Rivages. Et bien sûr, Kenzaburô Oé, grâce au Nobel. Mais cela dépasse difficilement les vingt mille exemplaires. Oé ne les atteint pas. Loin de là. Critique, traduction, édition, romans. Quelle est votre activité principale ? Selon les périodes, les unes prennent le dessus sur les autres. J'aurais tendance à dire que mon activité la plus profonde, la plus essentielle est celle de romancier. Mais l'édition, la critique me prennent aussi beaucoup de temps, parce que je n'aime rien faire superficiellement. Et que, contrairement à la plupart de mes confrères, j'aime beaucoup les autres écrivains... Extraits des propos recueillis par Alexandre Rosa dans Pagina
Bibliographie
En collaboration avec Ryôji Nakamura
En collaboration avec Alfredo Arias
* : à la médiathèque Bibliographie des traductions Traductions de litalien :
Traductions du japonais en collaboration avec Ryôji Nakamura :
Traductions de l'anglais :
* : à la médiathèque |

